
- Image via Wikipedia
Je n’avais guère envie de bloguer depuis quelques temps, mais là, j’ai craqué après la découverte d’une information sur twitter me renvoyant au site d’owni qui évoquait une conférence qui ne pouvait me laisser de marbre.
On croit rêver quand l’Ecole normale supérieur prend l’initiative d’inviter un individu, Pierre Bellanger, qui n’a rien à envier à Patrick Le Lay pour vendre du temps de cerveau disponible sur les ondes radiophoniques et sur le pire réseau de blogs à la fois au niveau technique, esthétique et en terme de contenus : les skyblogs. Ces derniers qui ont longtemps fait du mal à l’image même du blog.
La conférence est parfois, notamment au début, d’une médiocrité incroyable avec des banalités et des métaphores à peine digne d’une mauvaise copie du bac. Evidemment, on n’y apprend rien et on est consterné avec la récurrente métaphore de la toile, métaphore depuis longtemps rendue caduque notamment par l’étude du « nœud-papillon ».
Bellanger évoque une pensée « web native » et ressort toutes les visions stéréotypées sur le papier. On croirait parfois revoir des réflexions d’il y a 10 ans, du moins au début…car il est du coup tentant de ne pas tout écouter et pourtant ! Internet et ses boîtes invisibles et un modèle « réseau-centrique » sont parmi les pseudos concepts scientifiques utilisés. Mais s’il faut trouver un intérêt à la démonstration, c’est la réflexion qui repose sur la volonté de capter l’attention des usagers à des fins publicitaires qui est bien le but recherché.
« La marque devient une personne », étonnante phrase à l’heure du personal branding. Mais c’est justement l’objectif du rapprochement, l’égalité de façade. Evidemment, le discours peut paraître séduisant avec ce renouveau publicitaire.
La « publicité active » qu’il évoque, devient un service intégré…soit disant pour être plus utile notamment pour faciliter les relations mais en fait c’est le summum des rétentions tertiaires et de la délégation technologique. Ce marketing relationnel que nous présente Bellanger, c’est l’étape suivante du triomphe des industries de service qui vont chercher à s’immiscer davantage dans nos vies, à devenir de plus en plus discrètes voire invisibles. Cette discrétisation est une forme de grammatisation publicitaire qui prolétarisera davantage l’individu qui n’aura plus les moyens de distinguer ce qui relève de la publicité avec cette marque devenue personne. Le pire de tout c’est que cette entreprise vise à nous transformer en outils publicitaires, ce n’est plus l’individu-citoyen qui devient l’objectif de la formation, mais l’individu-marque. Pour ma part, c’est un cauchemar, le summum de la culture de la déformation, la poursuite du paradigme informationnel. Sur tous ces aspects de grammatisation, de pharmaka, de discrétisation, etc. il faut aller voir au moins le site d’ars industrialis et bien sûr lire les travaux de Bernard Stiegler.
Le plus étonnant chez Bellanger, c’est le discours mensonger qu’il utilise en mettant toujours en avant les idées de liberté d’expression ou de services aux usagers. Or, il ne fait rien qu’enfermer intellectuellement et parfois davantage. Ce qui est intéressant, c’est que désormais les attaques de ce type vont se multiplier sur le web et l’Internet. Cela démontre l’extrême complexité à l’œuvre et l’enjeu urgent autour d’une culture des hypomnemata. Cependant, vu que la formation est désormais passée sous la coupe de l’Oréal, il est à craindre que les stratégies présentées puissent avoir le champ libre pendant pas mal de temps. Les Jedis des différentes littératies tenteront de veiller néanmoins.
La présence des poissons rouges est étonnante : au niveau feng shui, le placement d’un tel aquarium vise à capter les mauvaises ondes à la place des habitants. Si on se voulait sinistre, les poissons rouges dans leur pauvre bocal nous font surtout penser à notre future situation sur les réseaux.
J’en profite pour rajouter un extrait de ma thèse qui évoquait les skyblogs et les jeunes générations.
Le site skyrock.com et les blogs qui y sont associés ne sont pas conçus pour une lecture approfondie mais surtout pour attirer l’œil et l’envie de cliquer. Le zapping instinctif y est privilégié par rapport à une lecture réfléchie. Si la page d’accueil des blogs est plus fournie en textes, la qualité orthographique se trouve supplantée par un style proche du Sms. Le fond de page des sites de skyrock est un fonds publicitaire qui change quotidiennement. Pour un peu, voilà un système qui exploite au maximum les négligences, en incitant à cliquer sans réfléchir et en ne lisant que très succinctement.
Voilà qui démontre le fort éloignement de la skholé, ce qui a priori apparaît logique puisque la plateforme est justement à l’extérieur du domaine de l’étude (studium) et donc du studium legendi. Cependant, il ne s’agit pas pour autant du loisir de l’homme libre que constitue l’otium, car l’exercice d’écriture de soi que peut constituer le blog se trouve emprisonné dans des démarches de conformisme et d’invasion publicitaire. Nous sommes surtout dans le domaine du neg-otium, celui du des sphères marchandes.

Figure n°24. La prédominance publicitaire sur la page http://www.skyrock.com/blog/
Alain Giffard a également observé ce type de blogs et en conclut qu’il s’agit de systèmes non ouverts vers l’extérieur mais au contraire essentiellement tournés sur eux-mêmes et donc contraire à l’esprit du web :
Sur Skyblog, on recherche l’inverse : on met les jeunes à l’écart. On les sépare de l’ensemble du web en les empêchant de se mettre en relation avec cet espace.
Le milieu est donc celui d’un milieu dissocié où l’individuation ne peut se produire car elle se trouve court-circuitée par des modèles qu’il faut suivre, impulsés notamment par la publicité. Ce qui est recherché est la captation de l’attention à des fins publicitaires. Seulement, les jeunes utilisateurs de skyrock n’en sont pas conscients, tant le discours est celui de la libre expression. Or c’est pourtant tout l’inverse qui se produit. Les productions des adolescents sur les skyblogs se ressemblent énormément avec les mêmes processus d’écriture et d’utilisation des photos des autres. Finalement, la plateforme skyblog enferme l’adolescent dans des schémas préétablis.
<http://www.skyrock.com/> Sur la page d’accueil du site, il n’y pas de textes longs, que des mots courts ou des images animées qui donnent envie de cliquer à l’adolescent.
2 <http://www.skyblog.com/>
3 Ivan ILLICH. Du lisible au visible : La Naissance du texte, un commentaire du «Didascalicon» de Hugues de Saint-Victor. Op. cit.
4Interview d’Alain GIFFARD. Skyblogs, la grande secte molle. In L’école des parents N°577- Hors-série mars 2009 – Adolescents : Confidences sur Internet. Disp. Sur :
<http://www.ecoledesparents.org/revue/N577_libreacces.html>
update : Je trouvais guère novateur l’idée d’une networked literacy, mais après tout, ce n’est peut-être pas si idiot au vu des risques exposés.


![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=0f7d37a3-0e6e-4e4a-98ba-54d6334bc810)
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=16e17054-a7f3-4ce5-b01c-033ff9e39d5a)

![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=d7c89764-7e71-404f-a9c4-f66c90a00369)
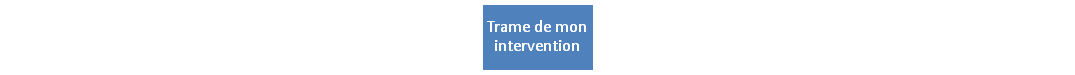


![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=4bf6c394-5037-46c8-b7b6-44e20399c9ed)

![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=5a7a4e8f-ceab-4605-8b1d-a9b5877999e9)