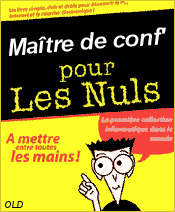Au sein du Cyberespace source de déperdition
Lieux de bévues et de tragiques méprises
Départis toi d’une totale maîtrise
Mais ose partir en expédition
Apprends à t’y perdre parfois
Pour faciliter le retour en soi
………….
Est-ce pour mieux percevoir la qualité
Parmi une masse qui nous frappe par sa quantité
Qu’il faut apprendre à mieux évaluer
Le moindre grain des infosphères polluées ?
……….
De la culture de soi face à au culte de l’ego
Se noue la trame d’un commun destin
Celui qui dépasse le mythe des égaux
Au-delà des affres d’un avenir indistinct
Pour raviver l’espoir de mémoires vives
Comme autant d’intelligences collectives