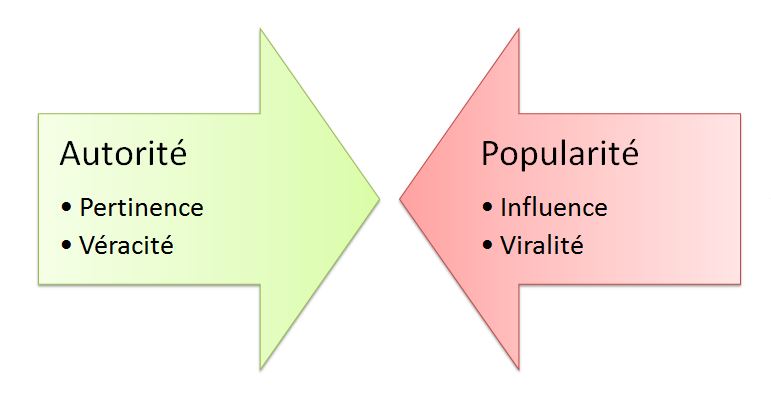Merci Bernard.
Merci Bernard pour avoir éclairé le débat et mes réflexions personnelles et théoriques plus d’une fois.
Merci aussi à Alexandre Serres pour m’en avoir parlé . Cela m’avait permis de découvrir ses travaux pionniers sur la technique et le temps.
Puis j’avais poursuivi l’aventure notamment durant ma thèse où les réflexions sur les enjeux de formation des nouvelles générations (notamment avec l’ouvrage Prendre soin), la question de l’attention (question essentielle encore et toujours plus actuellement) et bien sûr les enjeux de majorité de l’entendement et de majorité technique, rentraient pile dans mes réflexions du moment.
J’avais même osé il y a quelques années produire une carte mentale des idées de Stiegler, notamment son livre « réenchanter le monde ». J’avais fait cela en 2007 durant ma thèse, il y a fort longtemps désormais.
La lecture de Stiegler m’avait bien aidé aussi pour la réalisation de mes cours. Cela conférait de suite une puissance supplémentaire pour prendre un peu de hauteur sur des problématiques techniques, systémiques et informationnelles. Je peux aussi avouer que c’est en exposant des éléments liés à sa pensée que j’ai pris le plus de plaisir à enseigner. De cela, je me sens fortement redevable.
Bien sûr, on pouvait avoir des désaccords avec certains de ses points de vue, mais il ne laissait pas indifférent.
Et surtout, il était parvenu à plusieurs reprises à stimuler non seulement la réflexion, mais à impulser l’idée qu’il fallait innover et donc intégrer la technique au dispositif de réflexion, mais aussi aux dispositifs d’expérimentation.
La philosophie se trouvait étroitement mêlée à l’ingénierie, et c’était assurément un point fort autour d’ars industrialis et de l’équipe de l’Institut de Recherche et d’Innovation de Georges Pompidou.
Désormais, il faut poursuivre dans cette logique expérimentale et d’innovation plutôt que dans l’approche uniquement critique qui me semble dominante dans les SHS à l’heure actuelle. L’heure n’est donc pas aux épigones et encore moins dans les héritages directs.
Je crois que Bernard Stiegler aurait plutôt aimé l’idée que sa pensée subisse des transformations, des bifurcations, des sauts réticulaires plutôt que des lignes directes.
Stiegler a tracé un nouvelle « ligne de temps » propre à lui-même. A nous maintenant de transformer la ligne en des milliers d’autres pistes.
« Saint Bernard » est l’expression qu’emploie Jean-Max Noyer parfois tant l’influence de la pensée du philosophe était trop grande chez beaucoup d’entre nous, notamment dans l’axe E3D du Mica avec Franck Cormerais.
Il ne s’agit donc pas de le sanctifier, mais de veiller à la dynamique qu’il a cherchée à impulser depuis plusieurs décennies. Le bonhomme est parti, mais son œuvre reste.
Pensées et amitié à ses proches et à tous ceux qui lui doivent quelque chose, comme un début de réflexion, un début d’éclaircissement voire l’envie d’expérimenter quelque chose de nouveau en dehors des évidences.