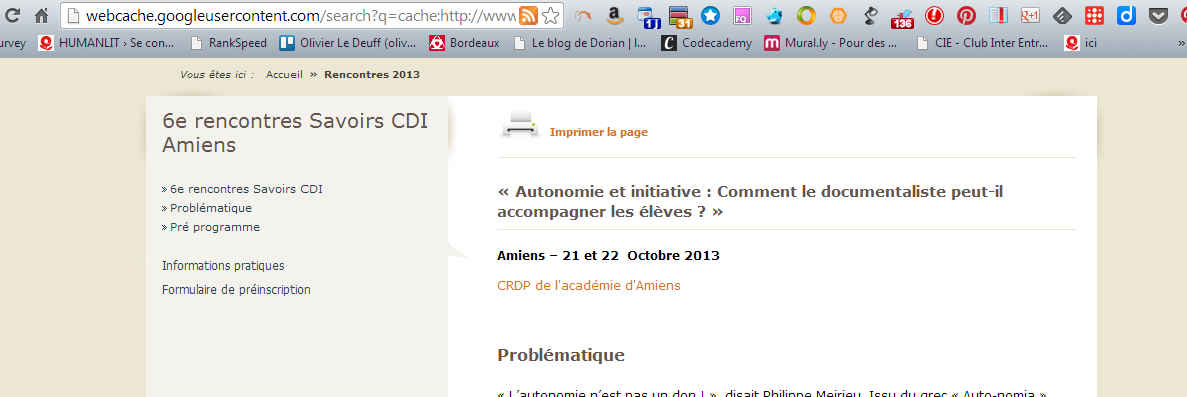Vouloir simplifier les intitulés de diplômes parait une velléité plutôt louable de prime abord. Il est en effet difficile de distinguer la somme des licences et masters possibles pour un étudiant ou pour des parents quelque peu inquiets. Seulement, est-ce le choix le plus opportun quand il fait suite à une logique qui était celle d’une individualisation des diplômes, une concurrence souhaitée, voire d’ancrages territoriaux ? C’est la question que pose avec justesse, comme bien souvent d’ailleurs, Pierre Dubois.
Alors que dans mon Iut, on s’interroge sur cette réduction des intitulés et qu’il faut bien avouer qu’on ne parvient pas à s’y retrouver du tout, si ce n’est qu’on a l’impression d’être un peu partout à la fois et donc nulle part en fait. Cette problématique est bien connue, c’est celle des arborescences. Simplifier les intitulés finit par présenter des risques, notamment celui d’être mal catégorisé, d’autant qu’on ne peut l’être qu’à un seul endroit. On est en train en train de nous rejouer le coup de l’annuaire, alors que c’est la logique du moteur qui prime. La logique de l’annuaire est hiérarchique et on comprend de suite que la vision réductrice du ministère l’est également. Plus on peut caser le tout dans des boites qui s’empilent, plus cela parait mieux organisé. Or c’est en fait l’inverse, s’il est bien quelque chose d’évident, c’est qu’un classement ou une indexation est toujours discutable et qu’il est préférable quand c’est possible et c’est ici le cas, comme pour un document numérique, d’opter pour plusieurs critères de classement plutôt que de choisir des intitulés. Car finalement, les grandes catégories existent déjà, ce sont les départements responsables de ces diplômes. Au final, il est préférable d’opérer pour des titres de diplômes avec de la liberté, du moment qu’il est bien adossé à des départements officiels. Car les responsables de diplôme n’ont guère envie de voir leur licence mal classée du fait de contraintes ministérielles.
C’est la logique du moteur qui prédomine désormais. Que vous soyez étudiants ou parents, vous allez aussi passer par ce biais pour trouver des diplômes qui correspondent à vos attentes. La logique de l’annuaire est trop contraignante pour des usagers habitués au bouton poussoir. Une erreur d’aiguillage, c’est autant de diplômes intéressants qui sont laissés de côté, car on n’a pas pensé à aller voir la catégorie voisine, dont on n’a pas bien saisi l’intitulé.
On s’éloigne totalement de la logique du web 2.0 et c’est dommage. Il faudrait davantage offrir différentes catégorisations au diplôme quitte à faire une classification fermée réalisée par des professionnels qui pourraient être complétée par des mots-libres. Et pourquoi ne pas envisager une base des fiches de diplômes qui permettraient aux diplômés de rajouter des tags voire des commentaires ? Cela sent la révolution ? On est loin du catalogue 2.0 pour le moment. Il est vrai que l’évaluation des enseignements par les étudiants reste encore taboue en France. Pour combien de temps encore ? Il faut incontestablement introduire un peu de popularité dans nos systèmes d’autorité. Cela devient nécessaire, la légitimité repose sur un juste équilibre entre autorité et popularité.
L’idéal serait donc de ce fait de quitter les arborescences pour se rapprocher des graphes et de proposer des visualisations de diplômes à partir de requêtes en mixant sur les catégories déterminées, les tags et toute autre stratégie de recherche d’informations. Cela aiderait bien aussi les conseillers d’orientation.
Voilà de quoi, lancer un projet de recherche avec la réalisation d’une application bien utile pour tous plutôt que d’opter pour la solution hiérarchique compressive. A noter qu’étrangement, les mouvements de réunification des universités aboutissent à des logiques inverses, puisqu’ils ne font que créer des entités nouvelles, si bien que les couches hiérarchiques ne cessent de s’amonceler. Il y a de plus en plus d’échelons entre le ministre de la Recherche et un simple salarié. Cette inflation administrative a déjà condamné l’Education Nationale à une asphyxie dont elle ne se relèvera probablement plus en produisant des mandarins tout aussi incompétents qu’indéboulonnables.
Il est temps d’ouvrir nos champs de vision et nos méthodes d’organisation de l’information au plus haut niveau. Car une des leçon de la documentation, c’est que derrière tout classement ou méthode d’organisation des éléments, il y a toujours une vision politique.