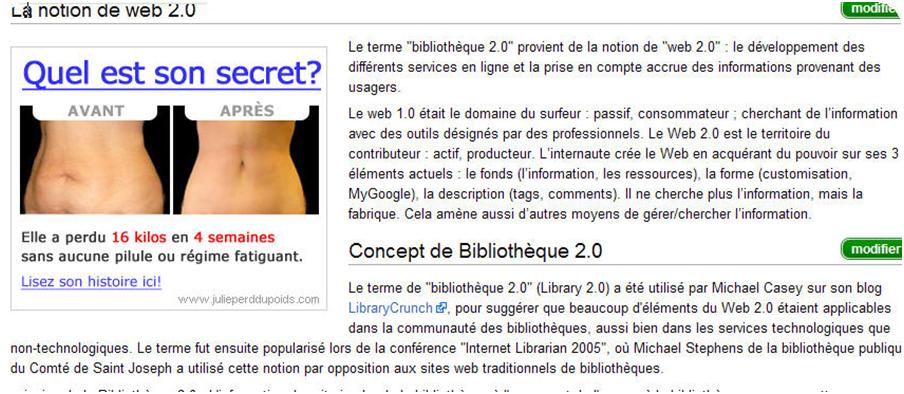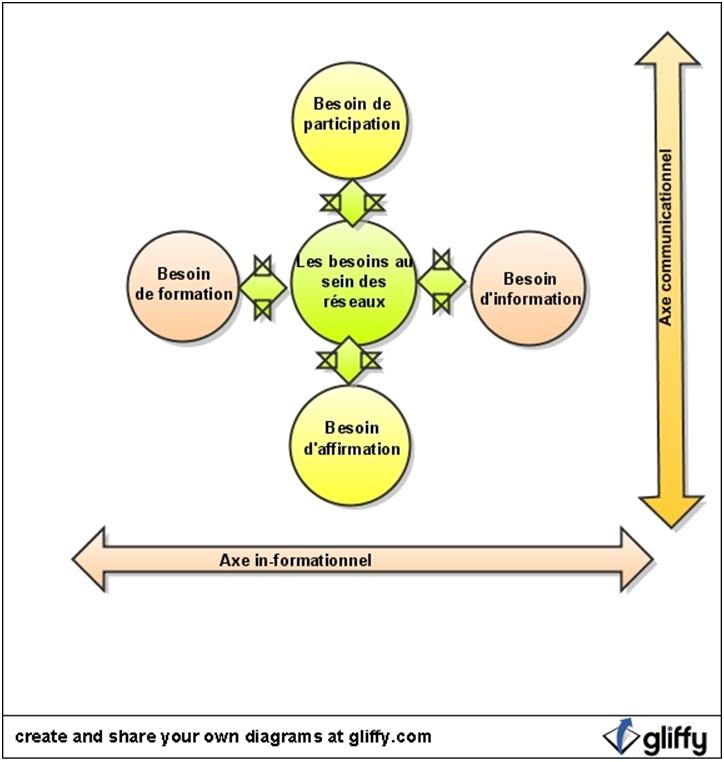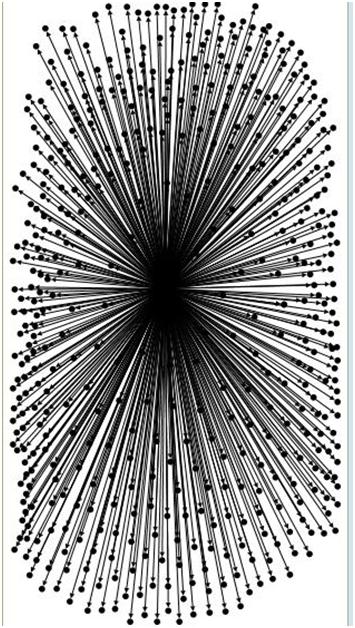Alors qu’Howard Rheingold évoque une twitter literacy, participant ainsi aux nombreuses littératies issues du numériques, il m’a semblé opportun de faire un rappel sur la notion de littératie avec un morceau extrait de ma thèse. Comme elle fait plus de 400 pages, je distillerai de temps en temps, certains passages pour éclairer quelques évènements particuliers. Le concept mérite qu’on s’y arrête plus longuement d’autant que l’association américaine de bibliothécaires, l’ACRL vient d’ouvrir un wiki qui associe littératie et science avec l’idée d’une science information literacy.
Une démarche qui démontre la volonté de rationalisation des savoirs qui s’opère dans le domaine de la formation à l’information.
Selon Régine Pierre, le terme apparaît pour la première fois en français en 1985 et son usage en tant que concept dans une revue scientifique n’est avéré qu’en 1991.
C’est un terme fortement utilisé notamment par les canadiens qui poursuivent beaucoup d’études dans le domaine et qui l’utilisent tel quel comme la traduction du terme literacy. La définition qu’ils en donnent nous éclaire sur l’élargissement de sens du concept :
Dans les grandes lignes, nous pouvons décrire la littératie comme un déterminant clé des chances d’une personne, que ce soit du point de vue de la carrière ou de la qualité de vie. Plus qu’une simple mesure des compétences en lecture, la littératie sert à évaluer la façon dont les adultes utilisent l’information écrite pour fonctionner en société. De fortes compétences en littératie sont étroitement liées à la probabilité d’obtenir un bon emploi, à des gains décents, et à l’accès aux possibilités de formation. (…)Traditionnellement, la littératie a fait référence à la capacité de lire, de comprendre, et d’utiliser l’information. Cependant, la signification du terme s’est élargie pour englober une gamme de connaissances, de compétences et d’habiletés qui ont trait à la lecture, aux mathématiques, aux sciences, et plus encore. Cet élargissement du sens reflète les changements profonds et généralisés qui se sont produits dans les domaines de la technologie et de l’organisation du travail au cours des 25 dernières années.
Un élargissement confirmé par la définition qu’en donne l’UNESCO en prônant une functional literacy :
A person is functionally literate who can engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning in his group and community and also for enabling him to continue to use reading, writing and calculation for his own and the community’s development.
Selon Eric Delamotte, la « literacy » « recèle le pari implicite, celui de réconcilier pratiques sociales et disciplines scolaires. » Eric Delamotte montre également l’étendue du concept :
Le concept a, d’abord, une assise anthropologique, car l’idée qui lui est sous-jacente est qu’il existe un lien entre l’apparition de l’écrit dans les sociétés et de nouveaux modes de pensée ou de raisonnement. Ensuite, la Literacy représente non seulement la prise en compte d’une évolution culturelle, mais elle introduit aussi une prise de position dans les débats sur l’éducation. Enfin, la Literacy est pragmatique et volontariste. Le mot important, ici, c’est évidemment « volontariste » qui indique que des objectifs précis sont définis et que des moyens et démarches sont consciemment mis en place pour les atteindre..
L’usage du terme de littératie implique un lien avec l’écriture et les rapports que la culture entretient avec la raison graphique. Mais il ne faudrait pas voir dans la littératie une vision simplement basée sur l’alphabétisme mais bel et bien sur le concept de texte tel qu’il est défini par Yves Jeanneret. L’article de Régine Pierre démontre bien les réelles ambitions du concept de littératie et de sa lente reconnaissance en français. Elle montre, en s’appuyant sur des travaux de chercheurs anglo-saxons, qu’il convient bien de la distinguer de l’alphabétisation car selon elle la littératie est une démarche qui débute bien avant l’apprentissage scolaire. Elle considère d’ailleurs que la functional literacy, évoquée d’ailleurs par l’UNESCO, n’est pas une valeur universelle mais diverge selon les lieux et les époques :
Le concept de littératie fonctionnelle englobe des réalités différentes selon les époques, les sociétés et les groupes sociaux (…). Ainsi savoir lire n’a plus la même signification pour les enfants d’aujourd’hui qui sont nés après la Révolution informatique que pour les enfants du début du XXe siècle pour qui la scolarisation primaire n’était même pas encore obligatoire.
Elle situe d’ailleurs la confusion entre alphabétisation et littératie a un autre niveau que celui du simple problème terminologique.
Nous sommes ici dans la nécessité de faire face à la confusion développée notamment dans les discours. Il s’agit d’opérer une distinction entre ces différents concepts pour mieux distinguer celui de littératie :
Le fait de maîtriser l’écrit pour pouvoir penser, communiquer, acquérir de nouvelles connaissances, résoudre des problèmes, réfléchir sur notre existence, partager notre culture ou se distraire est ce qui définit le type et le niveau de littératie atteint par des individus que l’on dira lettrés – litterati – au sens où l’entendait Cicéron qui posait la littératie – scientia litteratura – à la fois comme le fondement de la sagesse et de l’éloquence (…). Au plan individuel, le concept de littératie réfère à l’état des individus qui ont assimilé l’écrit dans leurs structures cognitives au point qu’il infiltre leurs processus de pensée et de communication et que l’ayant ainsi assimilé, ils ne puissent plus se définir sans lui (…). Un parallèle peut être établi, au niveau individuel, entre le concept d’intelligence qui est une mesure du degré d’assimilation par un individu des connaissances sur le monde et le concept de littératie qui est une mesure du degré d’assimilation des connaissances sur l’écrit.
L’enjeu posé par la littératie est donc bien différent de celui de l’alphabétisation, plus ambitieux, au final plus proche de la définition de l’homme cultivé d’Hannah Arendt. Le concept renvoie également à ce qu’on pourrait qualifier de représentation du monde (Weltanschauung) et se trouve donc fortement lié avec le concept de culture à tel point que l’on pourrait intervertir les deux termes et dire que la littératie donne forme à l’esprit pour paraphraser Bruner. Une dimension culturelle qui nous ramène fortement avec l’adjonction du mot information à l’étymologie de cette dernière, c’est-à-dire au moule, lieu de formation et de déformations. Une transformation qui s’opère autant sur les esprits que sur les corps selon Tracy Whalen :
Tout d’abord, la littératie met les corps en jeu. La littératie, en ce sens, se rapproche beaucoup de la notion d’habitus d’Aristote, idée développée par le sociologue français Pierre Bourdieu (1991), les dispositions durablement inculquées que nous développons au cours de nos vies, qui signalent notre aisance et nos aptitudes dans le monde.
La littératie ainsi définie, il convient de s’interroger sur la résistance du concept face aux mutations du numérique.
(la suite prochainement)
Statistique Canada. La littératie compte. In Statcan. Disp. sur : <http://www.statcan.ca/francais/freepub/81-004-XIF/200404/lit_f.htm>
2 UNESCO. Revised recommendations concerning the international standardization of educational statistics, UNESCO’s standard-setting instruments, V3 B4, UNESCO, 1986
3 Eric DELAMOTTE. « Information and knowledge literacy. ». Esquisse. Eduquer à /par l’information,
janvier 2007, no 50- 51, p.41-53
4
« Nous pouvons considérer comme des textes une affiche et le jeu qu’elle établit entre images et mots écrits, l’organisation de l’écran d’accueil de notre ordinateur (…), le découpage reconnaissable d’un journal télévisé. Parle de texte, c’est simplement indiquer qu’une forme générale doit organiser un espace d’expression pour qu’il soit lisible, que les messages ne nous parviennent que sous une forme matérielle, concrète, organisée. A cet égard, on peut dire que le texte est toujours un objet technique, mais d’une nature particulière : un objet techno-sémiotique » in Yves JEANNERET. Y a-t-il (vraiment) des technologies de l’information ? PU du Septentrion, 2007, p.106
5Régine PIERRE. « Entre alphabétisation et littératie : les enjeux didactiques » Revue Française de Linguistique Appliquée. 2003/1, Volume VIII, p. 121-137. p.124
6« Cette confusion entre alphabétisation et littératie déborde une simple querelle terminologique. Elle est le reflet d’une étonnante ignorance des origines de l’écriture et des mécanismes par lesquels l’Homme a développé et transmis la connaissance de cet outil qui façonne aujourd’hui nos existences. Dans tout ce débat terminologique, on confond l’écrit, l’écriture, la lecture et la littératie. » Ibid.., p.124
7
Ibid., p. 124
8 Jérôme BRUNER … car la culture donne forme à l’esprit: De la révolution cognitive à la psychologie culturelle. Retz, 1991
9Tracy WHALEN. « High Stakes, Mistakes, and Staking Claims : Taking a Look at Literacy / Grosses mises, méprises, mainmises : Regard sur la littératie. » Ethnologies, vol. 26, n° 1, 2004, p. 5-34. p.23