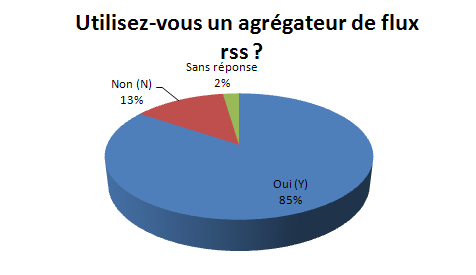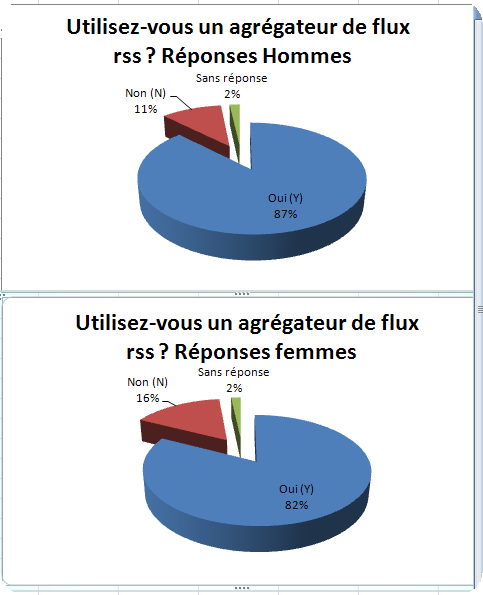Je relaie un appel à contributions pour le prochain congrès de la Fadben en 2012. La date limite a été fixée au 18 septembre.
La thématique autour des objets numériques comme objets d’enseignement constitue un prolongement intéressant aux derniers numéros du Mediadoc.
Objets documentaires numériques : nouvel enseignement ?
Paris Ile de France
22, 23 et 24 Mars 2012
Appel à contributions
Proposition à envoyer avant le 18 septembre 2011
Problématique :
Le début du XXIe siècle consacre le règne du numérique dans la production et la circulation de l’information. Un mouvement de convergence médiatique s’amorce ainsi avec l’intégration des supports traditionnels de communication et d’information sur un même média. Avec le web 2 et ses outils laissant une large part à l’interactivité, avec la démultiplication des réseaux sociaux, de nouvelles modalités de communication apparaissent. Plus participatives, ces modalités rendent l’utilisateur acteur de la production et de la circulation de l’information réinterrogeant par là ses façons de penser, d’agir et d’être. L’interaction avec les contenus, la personnalisation des informations et leur inscription sur les réseaux, les possibilités ouvertes par les traitements numériques, obligent à reconsidérer le concept d’information aussi bien dans sa nature que dans sa granularité. L’individu lui-même, de par sa présence sur les réseaux, se voit documentarisé et devient une entité informationnelle. Le concept de document est, quant à lui, bouleversé dans son essence même. Les nouveaux outils du web 2, nés de start-up animées par la recherche de modèles économiques viables, dessinent un paysage toujours mouvant, se recomposant à l’infini et donnant à croire qu’il n’y ait point de repères stables pour les penser, ni de continuité possible au-delà des incessantes ruptures qui les caractérisent. Une redocumentarisation du monde s’opère ainsi produisant de nouveaux objets documentaires et rendant nécessaire la recherche de repères pour l’usager, qu’il soit élève ou étudiant, consommateur, professionnel ou citoyen du monde. La « culture de l’information » est ainsi faite d’un ensemble de pratiques, de représentations, d’histoire des médias et des techniques, et de connaissances variées. L’entrée dans cette culture nécessite une éducation utilisant et étudiant à la fois les objets qui sont la source de son fondement et de son questionnement. Dans ce domaine comme dans tout autre, l’école tient un rôle essentiel et la médiation pédagogique à mettre en œuvre est sans doute à reconsidérer. Bien au-delà de l’intégration des outils numériques dans les pratiques d’enseignement, l’émergence de nouveaux objets documentaires produit de nouveaux objets d’enseignement et inscrit les apprentissages informationnels dans une perspective de convergence des littératies médiatique, numérique et informationnelle. Mais peut-on proposer des repères stables et structurants dans le flux continuel des innovations technologiques, accorder le temps long de l’étude à celui, trépidant, de la modernité numérique ? Comment les professeurs documentalistes peuvent-ils contribuer à relever ce défi ?
De nombreuses questions, situées au carrefour des sciences de l’information et des sciences de l’éducation, seront débattues au cours de ces trois journées. En relation avec la mission pédagogique qui fonde le métier de professeur documentaliste, cette problématique sera abordée selon les trois axes suivants :
1- Nouveaux objets documentaires, nouveaux objets informationnels : comment la question technique permet-elle de penser la culture de l’information ?
- Quel paysage informationnel se dessine aujourd’hui ?
- Quelle typologie des nouveaux objets documentaires et/ou informationnels ?
- L’émergence des médias numériques permet-elle une véritable démocratisation des connaissances ? Quel est le sens de la technique, entre émancipation et aliénation ?
- La pensée des techniques refonde-t-elle le concept de culture de l’information ?
- La culture de l’information a-t-elle une histoire ?
- Quelle est la part des savoirs et des procédures dans les pratiques d’information et de communication ?
2- Les nouveaux objets documentaires transforment-ils le rapport au savoir dans et hors l’école ?
- De la technique au savoir, quels enjeux éducatifs sont liés au passage, à l’école, d’une culture technique de l’accès à une culture de l’information ?
- Quelle place l’école fait-elle aux nouveaux objets documentaires ? Quels nouveaux objets de savoir accompagnent le renouvellement des pratiques ?
- Quel impact du numérique et des réseaux sur les capacités d’attention et d’apprentissage des élèves ? Les nouveaux objets documentaires modifient-ils la cognition ?
- Entre gestion des connaissances et transmission des savoirs, quels sont les apports et les limites de la psychologie cognitive ? Que révèle-t-elle concernant l’accès au savoir et la production du savoir via le numérique ?
- Comment articuler les avancées des sciences de l’information et les attentes de l’école en matière d’information-documentation ? Comment didactiser la culture de l’information ?
- Quel regard les sciences de l’éducation portent-elles sur l’éducation à la culture de l’information ? Quels peuvent être leurs apports ?
- Quelle forme scolaire proposer à la convergence des littératies médiatique, numérique et informationnelle ?
3- La posture pédagogique du professeur documentaliste : permanence ou changement dans le contexte du numérique ?
- Les évolutions technologiques impactent-elles les compétences professionnelles qui sont au cœur du métier de professeur documentaliste ? Quelles compétences constituent le cœur du métier aujourd’hui ?
- Quelle approche des réseaux numériques en contexte scolaire ? Pour quels usages et pratiques ?
- Quel regard le professeur documentaliste porte-t-il sur les pratiques informationnelles des élèves ?
- Les nouveaux objets documentaires : outils et/ou objets d’étude de l’information-documentation ? Quels nouveaux savoirs ?
- Les professeurs documentalistes ont-ils intégré ces nouveaux savoirs dans leurs pratiques pédagogiques ? Comment intégrer les nouveaux objets documentaires dans leur enseignement ?
- Faut-il inventer une nouvelle pédagogie documentaire ?
- Comment construire l’expertise informationnelle du professeur documentaliste ?
- La prise en compte d’un mandat pédagogique renouvelé permettra-t-elle de faire évoluer le métier de professeur documentaliste ?
Comité scientifique :
Eric Bruillard (ENS Cachan), Françoise Chapron (Université de Rouen), Eric Delamotte (Université de Rouen), Olivier Ertzscheid (IUT de la Roche sur Yon. Infocom), Cédric Fluckiger (Université de Lille 3), Divina Fraü Meigs (Université de Paris Sorbonne), Olivier Le Deuff (IUT de Bordeaux), Vincent Liquète (Université Bordeaux 4 – IMS), Yolande Maury (Université de Lille 3), Alexandre Serres (URFIST de Rennes).
Pour le bureau Fadben : Ivana Ballarini-Santonocito, Pascal Duplessis.
Calendrier :
- Date limite de soumission des propositions : 18 septembre 2011
- Sélection des interventions : 31 octobre 2011
- Envoi du texte de la communication : 28 janvier 2012
Modalités de soumission :
- Les propositions de communication comporteront :
◿ un titre,
◿ un résumé d’environ 6000 signes,
◿ la thématique et l’axe de la problématique dans lequel elle s’inscrit,
◿ le nom, le prénom et la qualité de l’intervenant, le cas échéant l’unité de recherche ou l’institution de rattachement, les adresses mail et postale de la personne dont émane la proposition.
- Chaque proposition sera examinée de façon anonyme par au moins 2 membres du comité scientifique qui enverra sa réponse le 31 octobre 2011.
- Les propositions sont à envoyer par courrier électronique à :
Valérie Boutrois : valerieboutrois@gmail.com
et Ivana Ballarini : i.ballasanto@orange.fr