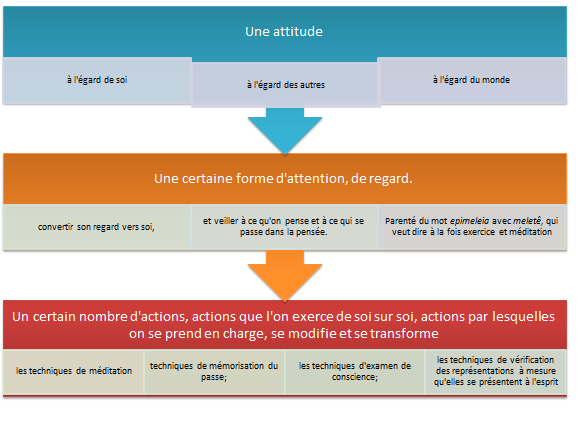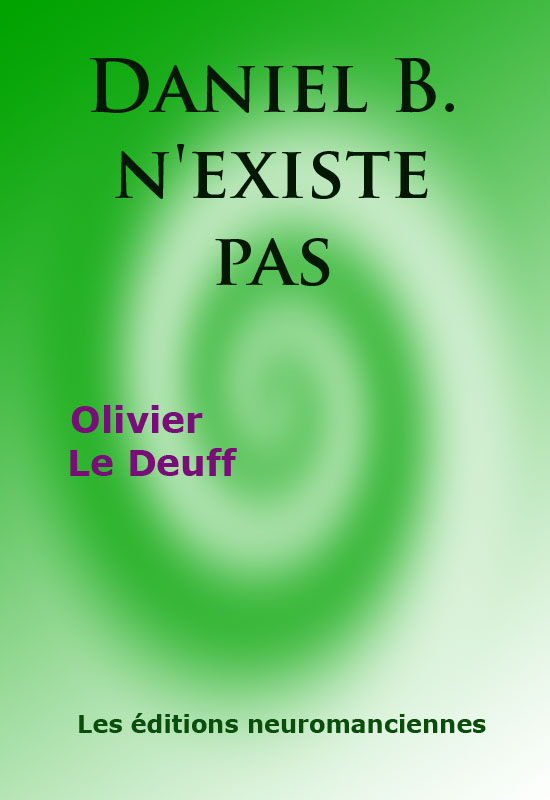L’information circule depuis quelques semaines mais il est temps en cette période estivale de continuer à diffuser l’information.
En effet, le prochain Thatcamp en France aura lieu en Bretagne ! Au menu du sérieux (de nombreux ateliers), du très sérieux (des séances de formation) et du fun (des olympiades que j’organise) autour des humanités numériques ou digitales, les fameuses digital humanities. On ne vous promet pas que vous allez manger des crêpes et galettes tous les jours, mais on ne vous empêchera pas. Vous serez dans le cité corsaire, dès lors un esprit un peu flibustier y règnera fortement.
Le site dédié est là.
J’apprécie beaucoup le logo qui me fait penser aussi à une chrysalide, si vous y rentrer, vous serez transformé, comme moi je l’ai été. Une chrysalide, ça me ramène aussi au dernier ouvrage de Murakami. J’y reviendrai à nouveau.
Mais comme vous êtes fatigué de cliquer à cause des pollutions type scoop.it, voici l’essentiel de l’information et surtout n’oubliez pas de vous inscrire :
Le prochain THATCamp francophone se déroulera les 18 et 19 octobre à Saint-Malo au Château de la Briantais. La capacité d’accueil est de 80 personnes. Des Olympiades DH, des ateliers formation (Gephi, Processing, Arduino, Rapsberry), et un workshop (« objets intelligents et déconnexion ») seront également organisés les 17 et 20 octobre.
Qu’est-ce qu’un THATCamp ?
« Un ThatCamp – The Humanities and Technology Camp – est une rencontre qui permet aux acteurs de la recherche en sciences humaines et sociales utilisant des technologies numériques de partager informations, idées, solutions et savoir-faire autour de leurs pratiques. Les ThatCamps sont organisés par les participants eux-mêmes. Le programme n’est pas établi à l’avance mais construit directement sur place. Un ThatCamp n’est pas constitué de conférences ex- cathedra mais prend la forme d’ateliers, où tous les participants sont invités à partager leurs connaissances. »Pierre Mounier, 12 juin 2012.
Thématiques THATCamp Saint-Malo 2013
Toutefois THATCamp Saint-Malo 2013 souhaite aborder les relations entre Humanités numériques et Bibliothèques : compétences en jeu, évolutions des profils et dialogue des bibliothèques avec la recherche, pratiques informationnelles des chercheurs…
THATCamp Saint-Malo 2013 a également pour ambition de rassembler pour la première fois la communauté des arts et du design concernée par les humanités numériques (conception de programme, design d’interface, design d’information, cartographie).
Enfin THATCamp Saint-Malo 2013 sera l’occasion pour la communauté francophone des humanités numériques et/ou digitales de songer à se constituer en association.
Inscription
Une liste d’inscription est ouverte jusqu’au 15 septembre à l’adresse suivante : http://barcamp.org/w/page/67372397/Inscriptions%20ThatCamp%20Saint-Malo#view=page
Proposition et suggestion d’atelier
Vous pouvez proposer ou faire des suggestions d’atelier à l’adresse suivante : http://barcamp.org/w/page/67372429/Propositions%20d’atelier
Equipe organisatrice
– Nicolas Thély, professeur en esthétique et humanités numériques à l’université Rennes 2.
– Alexandre Serres, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication et co-responsable de l’Urfist de Rennes.
– Erwan Mahé, responsable du laboratoire Design et Pratiques Numériques de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.
– Guillaume Pinard, artiste et professeur à l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.
– Olivier Le Deuff, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à Bordeaux 3.